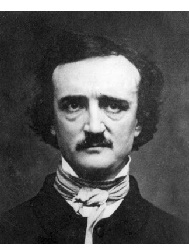
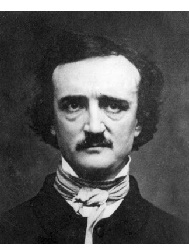
Edgar Allan Poe, (1809-1849) né à Boston, mort à Baltimore, est un écrivain, essayiste, poète et critique littéraire américain. Il est surtout connu pour ses contes, traduits en France par Charles Baudelaire. Certains le considèrent comme l’un des plus grands auteurs américains, d’autres comme l’un des pères du romantisme américain. D’autres disent que Poe traduit en français, c’est justement du Charles Baudelaire. Beaucoup plus controversé aux Etats-Unis qu’en France, tous s’accordent à reconnaître l’extraordinaire influence qu’il exerça sur le roman policier, le fantastique, la science-fiction et l’art du récit court en général.
Biographie
Edgar Allan Poe est né à Boston le 19 Janvier 1809. Sa mère est la fille de deux comédiens anglais, son père vient d’une famille de commerçants irlandais. Son père et sa mère sont acteurs ambulants, et c’est au cours d’une tournée à New York, que son père, alcoolique, tuberculeux, meurt, alors qu’Edgar est âgé de quelques mois. En 1811, à Richmond, tandis qu’elle fait une tournée dans le sud, sa mère meurt à son tour. Edgar reste constamment auprès de sa mère durant son agonie, qui durera quatre mois. On dit que cette relation fusionnelle avec sa mère et la disparition dont il fut le premier témoin influenceront grandement sa vie et son art. Peut être est-ce cette douleur, ce traumatisme d’enfant, qui feront de lui cet être déchiré, frustré, ambitieux, malheureux, et cet écrivain à l’imagination fertile mais au style sur travaillé, contrôlé à l’excès ? Orphelin, Edgar est recueilli par une famille de négociants de tabac de Richmond, les Allan. Né dans le Nord, il passe sa jeunesse dans le Sud, où il est élevé comme un patricien.
Entre 1815 et 1820, il suit sa famille adoptive en Grande-Bretagne où il fait des études classiques plutôt brillantes. Très tôt, Edgar montre une certaine difficulté à la vie sociale ; d’un caractère dur, il est à la fois rêveur et solitaire, irritable et colérique. Ses relations avec sa famille adoptive deviennent tendues. Entre son père et sa mère adoptive, il prend le parti de sa mère.
Edgar commence à écrire, d’abord des poèmes. Il lit Virgile, Ovide, Cicéron, il est influencé par Lord Byron. Mais les relations avec son père adoptif se détériorent. Tout en suivant toujours une éducation brillante, Edgar contracte des dettes de jeu. Le père adoptif, John Allan, refuse de payer les frais de l’Université, sabote les fiançailles d’Edgar et d’une jeune femme dont il était amoureux, Elmira Royster. A l’âge de dix-huit ans, Edgar s’en va. Il s’embarque sur un bateau sous un faux nom, puis encore sous un autre nom, il s’engage comme artilleur dans l’armée. Il voyage en Caroline, est stationné sur l’île Sullivan, qui servira de décor au Scarabée d’or, part en Virginie et finalement quitte l’armée. C’est à la même époque que le « militaire poète » publie à compte d’auteur un recueil de poèmes, Tamerlan.
En 1829, sa mère adoptive meurt. Il se réconcilie puis se brouille de nouveau avec son père adoptif. Il cherche son soutien avant de démissionner de l’armée puis d’intégrer West Point. Il finit par y être accepté, au début il y fait de brillantes études, puis il s’en fait renvoyer. Alors, fils de comédiens ambulants du Massachusetts, patricien virginien, adolescent en Angleterre, traumatisé par la mort de sa mère, puis par celle de sa mère adoptive, élevé sans père, en conflit avec son père adoptif, séparé de celle qu’il aime par le même père, brillant, difficile, asocial, attiré par les lettres classiques, poète, mais tenté à la fois par la carrière militaire, Edgar Allan est à la recherche d’une identité, d’un ancrage. Sa place, il la trouvera dans la littérature. Il laissera une œuvre originale, cohérente, d’une remarquable influence. Mais il ne connaîtra pas la gloire de son vivant.
Carrière littéraire
Il retourne à Baltimore, et éprouve beaucoup de difficultés à se faire publier ou à trouver le succès. Pour ne pas mourir de faim, il est aussi journaliste, pigiste. En 1835, il obtient enfin un poste comme critique littéraire au Southern Literary Messenger. Il s’attaque à des talents célébrés par la critique mais qui lui semblent usurpés. Il se marie, quitte le journal, on lui reproche son alcoolisme, et il publie Les aventures d’Arthur Gordon Pym qui n’obtient aucun succès. Puis il publie La chute de la maison Usher avec le Gent’s Mag. En 1840, il fonde son propre journal littéraire, le Pen Magazine. Puis en 1841 il rejoint le Graham’s Gentleman’s magazine ; il y gagne sa vie, s’attaque aux cercles littéraires dominants de New York et de Boston. Puis il rencontre Charles Dickens, évoque avec lui la protection du droit d’auteur international (à l’époque, en l’absence d’une protection juridique claire, les livres anglais étaient publiés libres de droit aux Etats-Unis ; c’est d’ailleurs ainsi que des grosses maisons d’édition américaines firent fortune, en piratant les œuvres d’auteurs anglais célèbres, et ce sont les mêmes qui sont maintenant les plus ardents défenseurs du copyright… ; c’est embêtant, l’ignorance de l’histoire…). Afin de concilier besoins financiers et volonté d’écrire, il cherche à entrer dans l’administration, mais il n’y parvient pas. En 1845, il publie le poème Le corbeau, probablement le plus grand succès de son vivant. Sa femme Virginia meurt en 1847, il écrit Euréka ou Essai sur l’univers matériel et spirituel, un ouvrage qu’il considère comme l’un de ses plus importants. Il a des problèmes avec l’alcool. Ses conférences sur Le principe poétique rencontrent un grand succès : la première à Providence, puis la seconde à Richmond. En 1849, il meurt dans des conditions mystérieuses : on le retrouve ivre, battu et dans des vêtements qui ne sont pas les siens.
La théorie de l’effet unique
Il développe ses principales théories esthétiques et littéraires dans The philosophy of composition, traduit en France sous le titre Genèse d’un poème. C’est là qu’il explique la théorie de l’effet unique : le but de l’art est esthétique avant tout. Ainsi, le texte doit tendre vers sa propre réalisation, sans digressions, le texte n’a pas de rôle moral. C’est pour cela que Poe a finalement fait si peu de romans, et autant de contes ; le conte ou la nouvelle lui semblent appropriées à son projet littéraire et esthétique, la recherche d’une certaine forme d’harmonie, de perfection, par l’organisation de tous les éléments du texte vers un équilibre parfait, d’où tous les aspects non essentiels et nécessaires auraient été gommés. En cela très inspiré par les théories esthétiques d’un Aristote, nous pensons, il rejette l’hubris ou la fancy, c'est-à-dire l’imagination débridée, non contrôlée, laissée à elle-même et portée par son propre flux, au détriment de la recherche d’une forme de perfection et d’unité presque originelles. Tout doit donc tendre vers un but, une intrigue solide comme un câble métallique, autour duquel les personnages, les enchaînements tendent, agrémentés par un style homogène.
Le travail et le style de Poe
Quelles en sont les principales caractéristiques ? Poe est l’ennemi du spontané, de l’improvisation. Il n’hésite pas à reprendre son texte de nombreuses fois, afin d’arriver au résultat escompté, celui d’un texte où toute hésitation, élan non contrôlé de l’auteur aura été enlevé. Le texte, un peu à la manière classique, existe en soi. Tout travail vise à éliminer l’inutile, à resserrer le texte au maximum. Son caractère obsessionnel se manifeste aussi dans la tendance qu’il avait à reprendre ses textes déjà publiés en vue d’une réédition. En cela, Poe s’inscrit à l’opposé des grands romanciers fleuve ou feuilletonesques du Dix Neuvième siècle. Poe utilise beaucoup de mots complexes, d’origine latine, des mots polysyllabiques peu employés dans la langue anglaise, « phantasmagoric » plutôt que « strange » « spurious » plutôt que « fake », etc… Ensuite, ses phrases sont longues, parfois compliquées, les formules un peu alambiquées visent à la création d’une ambiance. Il utilise aussi de répétitions fréquentes, une multiplicité d’adjectifs, empruntant ainsi à la littérature anglaise plus classique, des images parfois surprenantes, nombreuses, qui tout en renforçant l’ambiance, tendent à alourdir la lecture.
La littérature américaine à l’époque de Poe
A l’époque, il n’existe pas de littérature américaine constituée. La seule forme de littérature nationale qui existait à l’époque, c’était des romans de la prairie comme Fenimore Cooper ou encore Washington Irving. Il existait aussi une mode des récits fantastiques, d’angoisse ou d’horreur, popularisés en partie par le Blackwood magazine, et influencés par le romantisme anglais de Ann Radcliffe, Shelley, ou Byron. L’ambition de Poe était de créer une véritable littérature nationale. Tout en restant très influencé par le Romantisme anglais, il voulait se démarquer de l’influence européenne sur la littérature américaine.
La cosmogonie de Poe : Eureka
Poe a produit d’importants écrits théoriques, influencés par Coleridge et Schlegel. Pour comprendre les conceptions littéraires précédemment exposées, il faut comprendre sa vision cosmogonique, exposée dans Euréka, fondée principalement sur l’intuition d’une unicité primordiale de l’univers. Il évoque une particule originelle, d’origine divine, à partir de laquelle la diversité présente du monde que nous avons sous les yeux se serait développée. Il anticipe, tout en multipliant les approximations et les erreurs scientifiques, le Big Bang, les trous noirs, il imagine que la mort n’existe pas vraiment, rejoignant ainsi une forme de transcendantalisme, et par ce travail, élève l’intuition poétique au dessus du rationalisme scientifique.
Poe et Charles Baudelaire
Poe a transformé Charles Baudelaire et Charles Baudelaire a transformé Poe. On dit que Baudelaire, lorsqu’il découvrit Poe, crut reconnaître dans ces textes certaines des images et des idées qu’il aurait eues par le passé. La réalité, c’est que Baudelaire développa une véritable passion, une obsession pour Poe, qu’il consacra dix-sept ans à la traduction de ses œuvres et qu’il ressentit, suite au premier choc de la découverte de l’œuvre de Poe, une affinité profonde entre sa poésie et les contes de l’américain. Sa vie difficile, sa pauvreté, l’alcoolisme, la dépression, tout ceci l’influence, lui offrent un modèle, et qui sait une raison d’être ? Là naît une relation fusionnelle d’outre tombe, qui influencera grandement l’art de Baudelaire .
Mais Baudelaire transformera aussi Poe. Baudelaire n’est pas un traducteur professionnel. Baudelaire n’a pas non plus à l’époque la formidable maîtrise de l’anglais que l’on lui suppose. Et si Baudelaire ne modifiera rien à l’intrigue, à la solidité du texte, il renforcera l’ambiance en apportant une poésie parfois manquant un peu dans l’original. Ainsi, aux forces de l’original, ambiance, logique, homogénéité, unicité d’intrigue, absence de digressions, imagination créatrice, grande originalité des thèmes, fantastique, policier, angoisse et suspense, horreur, symbolisme gothique, post chrétien, romantique, Baudelaire a ajouté une langue moins sèche, moins désincarnée, plus poétique, et Baudelaire a créé un Poe différent, dont l’influence sur le public français fut telle que Mallarmé lui aussi décida de le traduire, Lacan l’étudia, Marie Bonaparte en fit la psychanalyse… Mais c’est aussi la traduction et l’enthousiasme de Baudelaire pour l’auteur américain qui expliquent une autre des caractéristiques de l’héritage de Poe : l’existence de deux Poe littéraires, le Poe américain et le Poe français.
Image en France, image aux Etats-Unis
Ce fut l’une des grandes surprises d’un des premiers voyages américains des Editions de Londres, il y a de nombreuses années : la rencontre avec un professeur de littérature américaine qui sourit de mon enthousiasme pour Poe. Et maintenant, je comprends mieux. Poe est un auteur bien plus riche et complexe que ses détracteurs veuillent bien l’admettre. Et des détracteurs, aux Etats-Unis, il en a. Il suscite l’admiration de même qu’une certaine complaisance. En France, comme il a été réincarné par Baudelaire, il est hors de question, voire inintéressant d’en faire la critique. Mais aux Etats-Unis, ce n’est pas pareil. Et pourtant, si l’on s’intéresse de près aux critiques américaines, certaines raisonnables, d’autres franchement stupides, elles ont une certaine cohérence. Les admirateurs de Poe dans le monde anglophone sont souvent des non littéraires ou eux-mêmes des marginaux de la littérature, Hitchcock, Oscar Wilde, Lovecraft : ce sont l’ambiance et les histoires qui les influencent. Ses critiques s’en prennent au style, à la langue, débat totalement ignoré en France, et pour cause, Baudelaire. Mais, dans un débat si marqué entre les Américains et les Français, il faut probablement se tourner ailleurs pour trouver le mot de la fin, et ce n’est pas Jorge Luis Borgès, qui l’appréciait beaucoup et dont la langue parfois ésotérique et un peu désincarnée présente certaines vagues analogies avec celle de Poe ; c’est Fedor Dostoïevski qui, dans sa Préface aux trois récits d’Edgar Poe, compare le fantastique romantique de Hoffmann au fantastique matériel de Poe, dont il loue « l’art de suggérer le caractère plausible d’évènements surnaturels ».
L’influence de Poe
Tous s’accordent là-dessus : l’influence de Poe sur la littérature et l’art en général est tout bonnement extraordinaire.
Poe jette les bases du roman policier avec Dupin, qui influencera Conan Doyle. Il fonde les bases de la science fiction, influençant ainsi H.G. Wells, celles du roman d’aventures que reprendront Jules Verne, ou Stevenson, il créée le héros déchiré, introspectif qui influencera Dostoïevski…
En France, en Angleterre, aux Etats-Unis ou ailleurs, Poe est incontournable ; découvrons le dans cette édition bilingue.
© 2012- Les Editions de Londres
Aventure sans pareille d’un certain Hans Pfaall
Traduction de Charles Baudelaire (1856).
Avec un cœur plein de fantaisies délirantes
Dont je suis le capitaine,
Avec une lance de feu et un cheval d’air,
À travers l’immensité je voyage.
Chanson de Tom O’Bedlam.
D’après les nouvelles les plus récentes de Rotterdam, il paraît que cette ville est dans un singulier état d’effervescence philosophique. En réalité, il s’y est produit des phénomènes d’un genre si complètement inattendu, si entièrement nouveau, si absolument en contradiction avec toutes les opinions reçues, que je ne doute pas qu’avant peu toute l’Europe ne soit sens dessus dessous, toute la physique en fermentation, et que la raison et l’astronomie ne se prennent aux cheveux.
Il paraît que le… du mois de… (je ne me rappelle pas positivement la date), une foule immense était rassemblée, dans un but qui n’est pas spécifié, sur la grande place de la Bourse de la confortable ville de Rotterdam. La journée était singulièrement chaude pour la saison, il y avait à peine un souffle d’air, et la foule n’était pas trop fâchée de se trouver de temps à autre aspergée d’une ondée amicale de quelques minutes, qui s’épanchait des vastes masses de nuages blancs abondamment éparpillés à travers la voûte bleue du firmament.
Toutefois, vers midi, il se manifesta dans l’assemblée une légère mais remarquable agitation, suivie du brouhaha de dix mille langues ; une minute après, dix mille visages se tournèrent vers le ciel, dix mille pipes descendirent simultanément du coin de dix mille bouches, et un cri, qui ne peut être comparé qu’au rugissement du Niagara, retentit longuement, hautement, furieusement, à travers toute la cité et tous les environs de Rotterdam.
L’origine de ce vacarme devint bientôt suffisamment manifeste. On vit déboucher et entrer dans une des lacunes de l’étendue azurée, du fond d’une de ces vastes masses de nuages aux contours vigoureusement définis, un être étrange, hétérogène, d’une apparence solide, si singulièrement configuré, si fantastiquement organisé, que la foule de ces gros bourgeois qui le regardaient d’en bas, bouche béante, ne pouvait absolument y rien comprendre ni se lasser de l’admirer.
Qu’est-ce que cela pouvait être ? Au nom de tous les diables de Rotterdam, qu’est-ce que cela pouvait présager ? Personne ne le savait, personne ne pouvait le deviner ; personne, pas même le bourgmestre Mynheer Superbus Von Underduk, ne possédait la plus légère donnée pour éclaircir ce mystère ; en sorte que, n’ayant rien de mieux à faire, tous les Rotterdamois, à un homme près, remirent sérieusement leurs pipes dans le coin de leurs bouches, et, gardant toujours un œil braqué sur le phénomène, se mirent à pousser leur fumée, firent une pause, se dandinèrent de droite à gauche, et grognèrent significativement, puis se dandinèrent de gauche à droite, grognèrent, firent une pause, et finalement, se remirent à pousser leur fumée.
Cependant, on voyait descendre, toujours plus bas vers la béate ville de Rotterdam, l’objet d’une si grande curiosité et la cause d’une si grosse fumée. En quelques minutes, la chose arriva assez près pour qu’on pût la distinguer exactement. Cela semblait être, oui ! C’était indubitablement une espèce de ballon, mais jusqu’alors, à coup sûr, Rotterdam n’avait pas vu de pareil ballon. Car qui, je vous le demande, a jamais entendu parler d’un ballon entièrement fabriqué avec des journaux crasseux ? Personne en Hollande, certainement ; et cependant, là, sous le nez même du peuple ou plutôt à quelque distance au-dessus de son nez, apparaissait la chose en question, la chose elle-même, faite, j’ai de bonnes autorités pour l’affirmer, avec cette même matière à laquelle personne n’avait jamais pensé pour un pareil dessein. C’était une énorme insulte au bon sens des bourgeois de Rotterdam.
Quant à la forme du phénomène, elle était encore plus répréhensible, ce n’était guère qu’un gigantesque bonnet de fou tourné sens dessus dessous. Et cette similitude fut loin d’être amoindrie, quand, en l’inspectant de plus près, la foule vit un énorme gland pendu à la pointe, et autour du bord supérieur ou de la base du cône un rang de petits instruments qui ressemblaient à des clochettes de brebis, et tintinnabulaient incessamment sur l’air de Betty Martin.
Mais voilà qui était encore plus violent : suspendu par des rubans bleus au bout de la fantastique machine, se balançait, en manière de nacelle, un immense chapeau de castor gris américain, à bords superlativement larges, à calotte hémisphérique, avec un ruban noir et une boucle d’argent. Chose assez remarquable toutefois, maint citoyen de Rotterdam aurait juré qu’il connaissait déjà ce chapeau, et, en vérité, toute l’assemblée le regardait presque avec des yeux familiers ; pendant que dame Grettel Pfaall poussait en le voyant une exclamation de joie et de surprise, et déclarait que c’était positivement le chapeau de son cher homme lui-même.
Or, c’était une circonstance d’autant plus importante à noter, que Pfaall, avec ses trois compagnons, avait disparu de Rotterdam, depuis cinq ans environ, d’une manière soudaine et inexplicable, et, jusqu’au moment où commence ce récit, tous les efforts pour obtenir des renseignements sur eux avaient échoué. Il est vrai qu’on avait découvert récemment, dans une partie retirée de la ville, à l’est, quelques ossements humains, mêlés à un amas de décombres d’un aspect bizarre ; et quelques profanes avaient été jusqu’à supposer qu’un hideux meurtre avait dû être commis en cet endroit, et que Hans Pfaall et ses camarades en avaient été très probablement les victimes. Mais revenons à notre récit.
Le ballon - car c’en était un, décidément- était maintenant descendu à cent pieds du sol, et montrait distinctement à la foule le personnage qui l’habitait. Un singulier individu, en vérité. Il ne pouvait guère avoir plus de deux pieds de haut. Mais sa taille, toute petite qu’elle était, ne l’aurait pas empêché de perdre l’équilibre, et de passer par-dessus le bord de sa toute petite nacelle, sans l’intervention d’un rebord circulaire qui lui montait jusqu’à la poitrine, et se rattachait aux cordes du ballon. Le corps du petit homme était volumineux au delà de toute proportion, et donnait à l’ensemble de son individu une apparence de rotondité singulièrement absurde. De ses pieds, naturellement, on n’en pouvait rien voir. Ses mains étaient monstrueusement grosses, ses cheveux, gris et rassemblés par derrière en une queue ; son nez, prodigieusement long, crochu et empourpré ; ses yeux bien fendus brillants et perçants, son menton et ses joues, quoique ridées par la vieillesse, larges, boursouflés, doubles ; mais, sur les deux côtés de sa tête, il était impossible d’apercevoir le semblant d’une oreille.
Ce drôle de petit monsieur était habillé d’un paletot-sac de satin bleu de ciel et de culottes collantes assorties, serrées aux genoux par une boucle d’argent. Son gilet était d’une étoffe jaune et brillante ; un bonnet de taffetas blanc était gentiment posé sur le côté de sa tête ; et, pour compléter cet accoutrement, un foulard écarlate entourait son cou, et, contourné en un nœud superlatif, laissait traîner sur sa poitrine ses bouts prétentieusement longs.
Étant descendu, comme je l’ai dit, à cent pieds environ du sol, le vieux petit monsieur fut soudainement saisi d’une agitation nerveuse, et parut peu soucieux de s’approcher davantage de la terre ferme. Il jeta donc une quantité de sable d’un sac de toile qu’il souleva à grand-peine, et resta stationnaire pendant un instant. Il s’appliqua alors à extraire de la poche de son paletot, d’une manière agitée et précipitée, un grand portefeuille de maroquin. Il le pesa soupçonneusement dans sa main, l’examina avec un air d’extrême surprise, comme évidemment étonné de son poids. Enfin il l’ouvrit, en tira une énorme lettre scellée de cire rouge et soigneusement entortillée de fil de même couleur, et la laissa tomber juste aux pieds du bourgmestre Superbus Von Underduk.
Son Excellence se baissa pour la ramasser. Mais l’aéronaute, toujours fort inquiet, et n’ayant apparemment pas d’autres affaires qui le retinssent à Rotterdam, commençait déjà à faire précipitamment ses préparatifs de départ ; et, comme il fallait décharger une portion de son lest pour pouvoir s’élever de nouveau, une demi-douzaine de sacs qu’il jeta l’un après l’autre, sans se donner la peine de les vider, tombèrent coup sur coup sur le dos de l’infortuné bourgmestre, et le culbutèrent juste une demi-douzaine de fois à la face de tout Rotterdam.
Il ne faut pas supposer toutefois que le grand Underduk ait laissé passer impunément cette impertinence de la part du vieux petit bonhomme. On dit, au contraire, qu’à chacune de ses six culbutes il ne poussa pas moins de six bouffées, distinctes et furieuses, de sa chère pipe qu’il retenait pendant tout ce temps et de toutes ses forces, et qu’il se propose de tenir ainsi, si Dieu le permet, jusqu’au jour de sa mort.
Cependant, le ballon s’élevait comme une alouette, et, planant au-dessus de la cité, finit par disparaître tranquillement derrière un nuage semblable à celui d’où il avait si singulièrement émergé, et fut ainsi perdu pour les yeux éblouis des bons citoyens de Rotterdam.
Toute l’attention se porta alors sur la lettre, dont la transmission avec les accidents qui la suivirent avait failli être si fatale à la personne et à la dignité de Son Excellence Von Underduk. Toutefois, ce fonctionnaire n’avait pas oublié durant ses mouvements giratoires de mettre en sûreté l’objet important, la lettre, qui, d’après la suscription, était tombée dans des mains légitimes, puisqu’elle était adressée à lui d’abord, et au professeur Rudabub, en leurs qualités respectives de président et de vice-président du Collège astronomique de Rotterdam. Elle fut donc ouverte sur-le-champ par ces dignitaires, et ils y trouvèrent la communication suivante, très extraordinaire, et, ma foi, très sérieuse :
À Leurs Excellences Von Underduk et Rudabub, président et vice-président du Collège national astronomique de la ville de Rotterdam.
Vos Excellences se souviendront peut-être d’un humble artisan, du nom de Hans Pfaall, raccommodeur de soufflets de son métier, qui disparut de Rotterdam, il y a environ cinq ans, avec trois individus, et d’une manière qui a dû être regardée comme inexplicable. C’est moi, Hans Pfaall lui-même, n’en déplaise à Vos Excellences, qui suis l’auteur de cette communication. Il est de notoriété parmi la plupart de mes concitoyens que j’ai occupé, quatre ans durant, la petite maison de briques placée à l’entrée de la ruelle dite Sauerkraut, et que j’y demeurais encore au moment de ma disparition. Mes aïeux y ont toujours résidé, de temps immémorial, et ils y ont invariablement exercé comme moi-même la très respectable et très lucrative profession de raccommodeurs de soufflets ; car, pour dire la vérité, jusqu’à ces dernières années, où toutes les têtes de la population ont été mises en feu par la politique, jamais plus fructueuse industrie n’avait été exercée par un honnête citoyen de Rotterdam, et personne n’en était plus digne que moi. Le crédit était bon, la pratique donnait ferme, on ne manquait ni d’argent ni de bonne volonté. Mais, comme je l’ai dit, nous ressentîmes bientôt les effets de la liberté, des grands discours, du radicalisme et de toutes les drogues de cette espèce. Les gens qui jusque-là avaient été les meilleures pratiques du monde n’avaient plus un moment pour penser à nous. Ils en avaient à peine assez pour apprendre l’histoire des révolutions et pour surveiller dans sa marche l’intelligence et l’idée du siècle. S’ils avaient besoin de souffler leur feu, ils se faisaient un soufflet avec un journal. À mesure que le gouvernement devenait plus faible, j’acquérais la conviction que le cuir et le fer devenaient de plus en plus indestructibles ; et bientôt il n’y eut pas dans tout Rotterdam un seul soufflet qui eût besoin d’être repiqué, ou qui réclamât l’assistance du marteau. C’était un état de choses impossible. Je fus bientôt aussi gueux qu’un rat, et, comme j’avais une femme et des enfants à nourrir, mes charges devinrent à la longue intolérables, et je passai toutes mes heures à réfléchir sur le mode le plus convenable pour me débarrasser de la vie.
Cependant, mes chiens de créanciers me laissaient peu de loisir pour la méditation. Ma maison était littéralement assiégée du matin au soir. Il y avait particulièrement trois gaillards qui me tourmentaient au delà du possible, montant continuellement la garde devant ma porte, et me menaçant toujours de la loi. Je me promis de tirer de ces trois êtres une vengeance amère, si jamais j’étais assez heureux pour les tenir dans mes griffes ; et je crois que cette espérance ravissante fut la seule chose qui m’empêcha de mettre immédiatement à exécution mon plan de suicide, qui était de me faire sauter la cervelle d’un coup d’espingole. Toutefois, je jugeai qu’il valait mieux dissimuler ma rage, et les bourrer de promesses et de belles paroles, jusqu’à ce que, par un caprice heureux de la destinée, l’occasion de la vengeance vînt s’offrir à moi.
Un jour que j’étais parvenu à leur échapper, et que je me sentais encore plus abattu que d’habitude, je continuai à errer pendant longtemps encore et sans but à travers les rues les plus obscures, jusqu’à ce qu’enfin je butai contre le coin d’une échoppe de bouquiniste. Trouvant sous ma main un fauteuil à l’usage des pratiques, je m’y jetai de mauvaise humeur, et, sans savoir pourquoi, j’ouvris le premier volume qui me tomba sous la main. Il se trouva que c’était une petite brochure traitant de l’astronomie spéculative, et écrite, soit par le professeur Encke, de Berlin, soit par un Français dont le nom ressemblait beaucoup au sien. J’avais une légère teinture de cette science, et je fus bientôt tellement absorbé par la lecture de ce livre, que je le lus deux fois d’un bout à l’autre avant de revenir au sentiment de ce qui se passait autour de moi.
Cependant, il commençait à faire nuit, et je repris le chemin de mon logis. Mais la lecture de ce petit traité (coïncidant avec une découverte pneumatique qui m’avait été récemment communiquée par un cousin de Nantes, comme un secret d’une haute importance) avait fait sur mon esprit une impression indélébile ; et, tout en flânant à travers les rues crépusculeuses, je repassais minutieusement dans ma mémoire les raisonnements étranges, et quelquefois inintelligibles, de l’écrivain. Il y avait quelques passages qui avaient affecté mon imagination d’une manière extraordinaire.
Plus j’y rêvais, plus intense devenait l’intérêt qu’ils avaient excité en moi. Mon éducation, généralement fort limitée, mon ignorance spéciale des sujets relatifs à la philosophie naturelle, loin de m’ôter toute confiance dans mon aptitude à comprendre ce que j’avais lu, ou de m’induire à mettre en suspicion les notions confuses et vagues qui avaient surgi naturellement de ma lecture, devenaient simplement un aiguillon plus puissant pour mon imagination ; et j’étais assez vain, ou peut-être assez raisonnable, pour me demander si ces idées indigestes qui surgissent dans les esprits mal réglés ne contiennent pas souvent en elles, comme elles en ont la parfaite apparence, toute la force, toute la réalité, et toutes les autres propriétés inhérentes à l’instinct et à l’intuition.
Il était tard quand j’arrivai à la maison, et je me mis immédiatement au lit. Mais mon esprit était trop préoccupé pour que je pusse dormir, et je passai la nuit entière en méditations. Je me levai de grand matin, et je courus vivement à l’échoppe du bouquiniste, où j’employai tout le peu d’argent qui me restait à l’acquisition de quelques volumes de mécanique et d’astronomie pratiques. Je les transportai chez moi comme un trésor, et je consacrai à les lire tous mes instants de loisir. Je fis ainsi assez de progrès dans mes nouvelles études pour mettre à exécution certain projet qui m’avait été inspiré par le diable ou par mon bon génie.
Pendant tout ce temps, je fis tous mes efforts pour me concilier les trois créanciers qui m’avaient causé tant de tourments. Finalement, j’y réussis, tant en vendant une assez grande partie de mon mobilier pour satisfaire à moitié leurs réclamations, qu’en leur faisant la promesse de solder la différence après la réalisation d’un petit projet qui me trottait dans la tête, et pour l’accomplissement duquel je réclamais leurs services. Grâce à ces moyens (car c’étaient des gens fort ignorants), je n’eus pas grand-peine à les faire entrer dans mes vues.
Les choses ainsi arrangées, je m’appliquai, avec l’aide de ma femme, avec les plus grandes précautions et dans le plus parfait secret, à disposer du bien qui me restait, et à réaliser par de petits emprunts, et sous différents prétextes, une assez bonne quantité d’argent comptant, sans m’inquiéter le moins du monde, je l’avoue à ma honte, des moyens de remboursement.
Grâce à cet accroissement de ressources, je me procurai, en diverses fois, plusieurs pièces de très belle batiste, de douze yards chacune, de la ficelle, une provision de vernis de caoutchouc, un vaste et profond panier d’osier, fait sur commande, et quelques autres articles nécessaires à la construction et à l’équipement d’un ballon d’une dimension extraordinaire. Je chargeai ma femme de le confectionner le plus rapidement possible, et je lui donnai toutes les instructions nécessaires pour la manière de procéder.
En même temps, je fabriquais avec de la ficelle un filet d’une dimension suffisante, j’y adaptais un cerceau et des cordes, et je faisais l’emplette des nombreux instruments et des matières nécessaires pour faire des expériences dans les plus hautes régions de l’atmosphère. Une nuit, je transportai prudemment dans un endroit retiré de Rotterdam, à l’est, cinq barriques cerclées de fer, qui pouvaient contenir chacune environ cinquante gallons, et une sixième d’une dimension plus vaste ; six tubes en fer-blanc, de trois pouces de diamètre et de quatre pieds de long, façonnés ad hoc ; une bonne quantité d’une certaine substance métallique ou demi-métal, que je ne nommerai pas, et une douzaine de dames-jeannes remplies d’un acide très commun. Le gaz qui devait résulter de cette combinaison est un gaz qui n’a jamais été, jusqu’à présent, fabriqué que par moi, ou du moins qui n’a jamais été appliqué à un pareil objet. Tout ce que je puis dire ici, c’est qu’il est une des parties constituantes de l’azote, qui a été si longtemps regardé comme irréductible, et que sa densité est moindre que celle de l’hydrogène d’environ trente-sept fois et quatre dixièmes. Il est sans saveur, mais non sans odeur ; il brûle, quand il est pur, avec une flamme verdâtre ; il attaque instantanément la vie animale. Je ne ferais aucune difficulté d’en livrer tout le secret, mais il appartient de droit, comme je l’ai déjà fait entendre, à un citoyen de Nantes, en France, par qui il m’a été communiqué sous condition.
Le même individu m’a confié, sans être le moins du monde au fait de mes intentions, un procédé pour fabriquer les ballons avec un certain tissu animal, qui rend la fuite du gaz chose presque impossible ; mais je trouvai ce moyen beaucoup trop dispendieux, et, d’ailleurs, il se pouvait que la batiste, revêtue d’une couche de caoutchouc, fût tout aussi bonne. Je ne mentionne cette circonstance que parce que je crois probable que l’individu en question tentera, un de ces jours, une ascension avec le nouveau gaz et la matière dont j’ai parlé, et que je ne veux pas le priver de l’honneur d’une invention très originale.
À chacune des places qui devait être occupée par l’un des petits tonneaux, je creusai secrètement un petit trou ; les trous formant de cette façon un cercle de vingt-cinq pieds de diamètre. Au centre du cercle, qui était la place désignée pour la plus grande barrique, je creusai un trou plus profond. Dans chacun des cinq petits trous, je disposai une boîte de fer-blanc, contenant cinquante livres de poudre à canon, et dans le plus grand un baril qui en tenait cent cinquante. Je reliai convenablement le baril et les cinq boîtes par des traînées couvertes, et, ayant fourré dans l’une des boîtes le bout d’une mèche longue de quatre pieds environ, je comblai le trou et plaçai la barrique par-dessus, laissant dépasser l’autre bout de la mèche d’un pouce à peu près au delà de la barrique, et d’une manière presque invisible. Je comblai successivement les autres trous, et disposai chaque barrique à la place qui lui était destinée.
FIN DE L’EXTRAIT
______________________________________